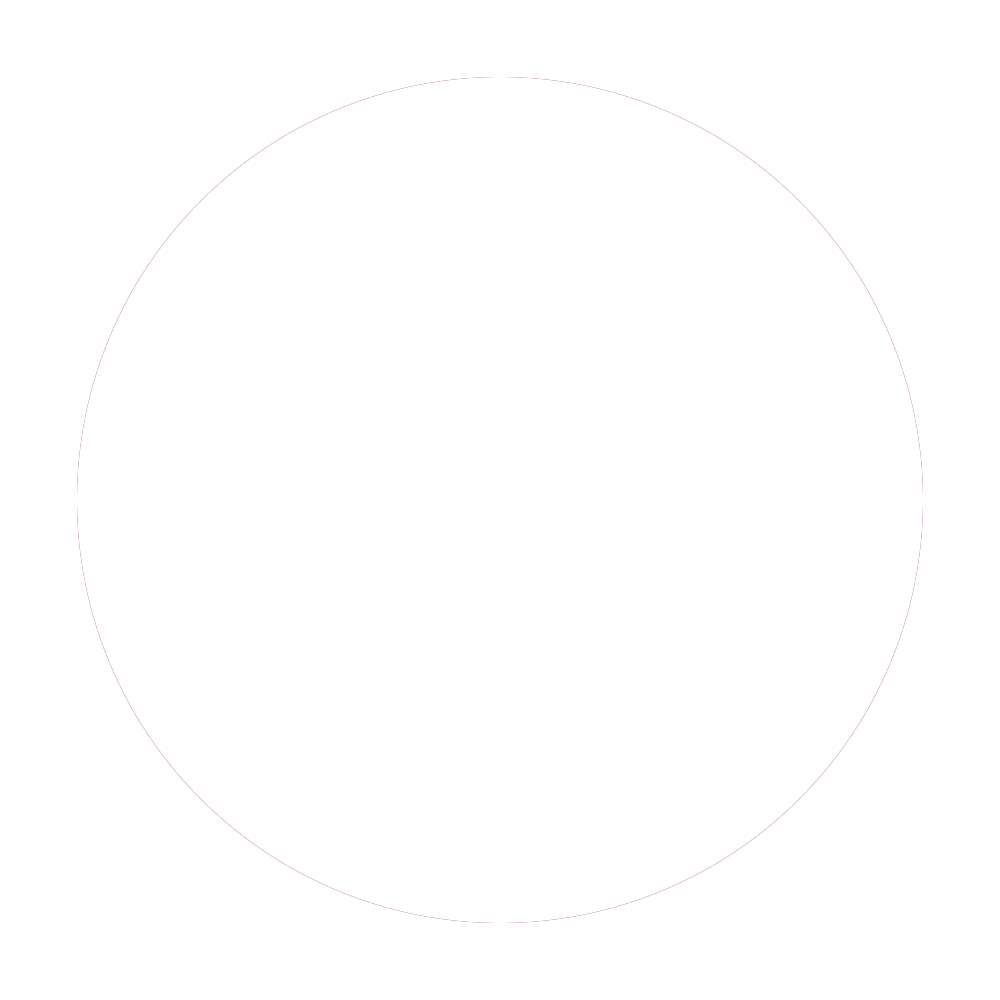Corvol. Un mot pour désigner le château bourguignon acquis par des immigrés juifs polonais au lendemain de la Shoah. Pour dire les colonies de vacances, leurs jeux et les liens d’affection qui continuent de s’y tisser. Pour parler d’une culture juive laïque et très marquée à gauche. Un mot enfin, pour dire ce qu’il reste ici et maintenant d’un idéal né à Vilnius en 1873, par-delà l’extermination de la majorité de ceux qui le portaient.
Le château des faucons rouges
Métro Jourdain, sept heures, le 13 juillet. La pluie parisienne tombe mollement sur le parvis de l’église. Une auto descend la rue de Belleville et stoppe au carrefour. Une dame en sort, s’avance vers moi en souriant « Annette Cisinski, enchantée ! Et voici mon mari Maurice Bacjz… D’ailleurs, nous nous sommes rencontrés à Corvol. C’était bien plus efficace qu’une agence matrimoniale !», plaisante la sexagénaire, élégante malgré son sweat-shirt à capuche griffé du dessin du château où nous devons nous rendre ensemble. Maurice prend le volant direction Corvol-L’Orgueilleux, à quelques collines de Clamecy, en Bourgogne. Chaque veille de fête nat’, le Club laïque de l’enfance juive (CLEJ) ouvre les portes de ses colonies de vacances aux parents afin de leur présenter ce à quoi s’occupe leur progéniture pendant trois semaines en juillet.
Le CLEJ investit dans ces colonies de vacances un espoir fou : faire vivre aujourd’hui en France l’esprit de son ancêtre, le Bund, fondé à la fin du XIXe siècle dans l’est de l’Europe. A l’époque en butte à l’antisémitisme et aux pogroms, cette union des travailleurs juifs de Pologne, de Lituanie et de Russie défend leur culture et leur langue, le yiddish. Contre les rabbins, aux ordres du tsar, ils se revendiquent résolument laïques. Face au sionisme, le parti assure que les travailleurs juifs doivent se battre « ici et maintenant » pour défendre leurs droits sociaux, plutôt que de rêver à une illusoire terre promise. Avec l’émigration des juifs polonais, le Bund essaime dans toute l’Europe, et notamment à Paris au début du XXe siècle.
Annette, dont le père était « bundiste », profite de l’autoroute pour nous conter la légende de Corvol, qui croise parfois son histoire. « Après la guerre, la grande majorité des militants du Bund avaient péri dans les camps. Les rescapés se sont mis à la recherche de leurs orphelins, éparpillés dans des familles à la campagne, et les ont réunis dans des « maisons d’enfants ». Il y en avait une au Mans, une à Maisons-Laffitte et une à Brunoy. Enfant, j’allais moi-même passer mes petites vacances là-bas », poursuit la jeune mamie.
Des vacances pour les orphelins
Le massacre de millions de juifs de l’est a tué le Bund, mais, dans l’immédiat après-guerre, son mouvement de jeunesse, le SKIF(Sotsyalistisher Kinder Farband), bouge encore. Corvol doit son existence à l’une de ses militantes et éducatrice, Cécile Steingart. « Cécile trouvait très injuste que nous, qui avions nos parents, puissions nous aérer pendant les vacances, alors que les orphelins restaient à la ‘maison d’enfants’ toute l’année ». En 1947, la jeune femme a le coup de foudre pour un grand château blanc, au cœur d’un parc immense, à Corvol-L’Orgueilleux. « Le propriétaire, un « collabo » notoire, en avait été expulsé, et le château mis aux enchères. Affaibli financièrement, le SKIF fait appel à une organisation humanitaire juive américaine, le Joint, pour acquérir la demeure », poursuit Annette. Les colos démarrent donc en 1947.
220 kilomètres et une escale chez un producteur de cerises plus tard, le voilà. Au travers des barreaux d’une longue grille, il se dresse. Sa blancheur tranche sur le vert de la prairie et des arbres qui le bordent. Les enfants galopent sur la pelouse, tandis que les adultes bavardent autour du buffet. Corvol, c’est aussi un clan : de génération en génération, on y envoie ses enfants, et bien souvent, les amours d’été finissent par lier par le sang des fratries entières. Le 13 juillet est l’occasion des retrouvailles.
En bonne doyenne, Annette propose une visite guidée. Suivie par quelques enfants curieux, toutes les parties du château sont passées au crible de ses souvenirs : « Cette salle est baptisée IKA, en hommage à une résistante arrêtée au local du Bund et décédée en détention au fort de Romainville le 5 octobre 1942. Dans le parc, la stèle sur la colline commémore Suzanne Szpielberg, morte à 16 ans d’une leucémie au printemps 1950. Le faucon rouge que vous voyez gravé dans la pierre était notre emblème », poursuit Annette, ravie de partager sa mémoire.
Tous les « corvolois » rencontrés par la suite entretiennent avec ce château un rapport de l’ordre du magique. « Chaque année, le château se ranime telle la Belle au bois dormant lorsque les enfants arrivent. Ils le connaissent comme leur poche, y ont leurs repères », explique un parent en passant. Il est aussi le témoin des générations de jeunes qui y ont séjourné depuis 1947.
Chemise bleue et foulard rouge
Car c’est dans ce grand château blanc que le SKIF va ressusciter au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le mouvement éduque les enfants, mêlant loisir et militantisme : « Pendant les vacances, se souvient Annette, on apprenait à lire et à écrire le yiddish. On portait fièrement notre uniforme, chemise bleue et foulard rouge, et on assistait au hissé du drapeau rouge tous les matins, puis on chantait des chants yiddish et révolutionnaires durant 30 minutes. Pour se dire bonjour et au revoir, on se disait « Amitié », et on n’employait pas le terme de « moniteur » mais celui d’ « Aide » ». Maurice, le mari d’Annette, était lui aussi un « faucon rouge » : « On nous racontait l’histoire du mouvement ouvrier, on parlait de l’actualité politique : c’était l’époque de De Gaulle, puis de la guerre d’Algérie. On allait aux manifs, on se baladait au bois de Vincennes. Parfois, on visitait une usine : une brasserie rue des Pyrénées, la rédaction de France -Soir ».
Malgré la saignée de la Shoah, durant une bonne décennie, le SKIF survit à sa maison mère, le Bund. Les deux mouvements partagent leur ADN politique, yiddishiste et socialiste. Dirigé vers la jeunesse, le SKIF s’intéresse en outre aux progrès de la pédagogie. Il s’inspire de Janusz Korczak, un pédagogue polonais auteur de l’idée de « République des enfants », mise en place dans ses orphelinats en 1912 : adultes et enfants édictaient ensemble les règles à l’oeuvre dans leur communauté, régulée par un tribunal et un parlement administrés par les enfants.
A partir de 1958, le SKIF décline. Voyant cela, en 1962, quelques anciens « faucons rouges » décident de reprendre les choses en main. « Nous nous réunîmes chez nous pour tenter de donner une nouvelle base à notre action militante et particulièrement assurer à nos enfants un judaïsme vivant pour contrecarrer celui qui se diluait au fil des ans », raconte Henri Minczélès, cofondateur du CLEJ, qui voit le jour en mai 1963. Le mouvement abandonne l’enseignement du yiddish : « Il n’y aurait plus une sorte de Bund polonais importé à Paris, mais plutôt une organisation judéo-française ne reniant certes pas l’idéologie bundiste, mais axée sur la réalité de notre pays : la laïcité républicaine, des valeurs éthiques de gauche et surtout sur le passé juif- la commémoration du soulèvement du ghetto de Varsovie et de la rafle du Vel d’hiv », explique-t-il encore. La charte du CLEJ, adoptée à cette occasion, déclare son attachement aux idées socialistes, à la culture juive sous toutes ses formes et à une pédagogie progressiste. « L’attachement à l’existence de l’Etat d’Israël » sera ajouté plus tardivement.
Retrouver la mémoire volée
Une fois le buffet dévasté, le directeur souffle dans une corne. Les adultes sont invités à se diriger vers le théâtre où les groupes des petits, des moyens et des grands se succèdent sur scène, mimant des moments-types d’une journée à Corvol. Lors de l’Agora, l’assemblée du matin, on apprend des mots en yiddish, puis on chante en choeur les mélodies du « cahier jaune », de Tumbabalaïka, un chant yiddish, à la Varsovienne, classique révolutionnaire en passant par Jusqu’à la ceinture de Graeme Allwright. Le « Kinderrat » est lui imité. « Les enfants doivent pouvoir y exprimer leur point de vue vis-à-vis de leur animateur, et sont en droit d’exiger une réponse argumentée », précisent les statuts de la colo. Les enfants prennent donc un malin plaisir à rejouer ce moment où ils se sentent plus puissants qu’à l’accoutumée.
Après le spectacle, devant le château, enfants et parents forment une ronde et répètent leur répertoire de danses israéliennes enflammées. Essoufflé et heureux, tout ce monde se dirige vers les grandes tables dressées sous le chapiteau, avec la ferme intention de se restaurer. Ma voisine de table, Sophie, corvoloise depuis ses sept ans, y envoie désormais ses deux fils. « Corvol, j’y ai tout fait, tout appris : les galères sous la tente, les « descentes » pour chiper des aliments en cuisine, puis, quand on était surpris, le « cercueil », le passage devant un conseil d’animateurs qui nous sanctionnait en nous badigeonnant le visage de dentifrice et de mayonnaise », s’amuse cette dame, aujourd’hui quarantenaire. Devant nous virevoltent les mets traditionnels yiddish : Klops (pain de viande), Käse kuchen (gâteau au fromage)… Ne manque plus que la carpe farcie.
Camaraderie
Entre deux explications sur la cuisine ashkénaze, Sophie expose: « Corvol est avant tout une vraie république des enfants : nous participions aux décisions, nous n’étions pas des petits soldats. Le moindre problème occasionnait des heures de discussions. J’y ai été tellement heureuse que je n’avais qu’une crainte : que cela ne plaise pas aux miens, d’enfants »… A la tablée suivante, Frédérique profite du café pour câliner son cadet, tout petit et tout roux. « J’ai inscrit mes trois fils à Corvol, d’abord parce que, les enfants revenant d’une année sur l’autre, je savais qu’ils s’y feraient des amis pour la vie. Ensuite, étant moi-même juive mariée à un goy, je veux que mes enfants héritent d’un judaïsme ouvert, et j’ai besoin de l’aide de la société pour cela », explique la maman. « Pour moi, il est important parfois que mes enfants ne se sentent pas différents des autres. Qu’ils puissent se dire juifs sans être minoritaires, et qu’ils sachent aussi qu’être juif, ce n’est pas vivre dans le royaume de la frime. Mais je ne les oblige à rien : paradoxalement, la colo a rendu mes enfants bien plus laïcs que je ne le suis moi-même ! », poursuit la maman. Puis elle se tourne vers son fils : « Toi, tu te sens comme les autres à l’école ? », lui demande-t-elle. Le petit garçon acquiesce. « Il est aussi possible que ce soit moi qui me pose trop de questions là-dessus », sourit Frédérique.
A la fin du repas, tables et chaises sont écartées, et assis par terre ou debout, les yeux rivés sur le cahier jaune fétiche, le groupe se transforme en chorale. Plus le moment de se séparer à nouveau se rapproche, plus l’émotion est palpable. Elle éclate au moment de chanter La Camaraderie, bras entrelacés, au moment du départ.
Barmitsva laïque
Pour rentrer à Paris, Béatrice, maman de Jules et Anna, m’accueille dans sa petite voiture. « Cela fait trois ans que Jules va à la colo. Mon père était juif, mais très laïc, et il ne m’a pas légué ce pan de sa culture. J’ai voulu que mon fils n’ait pas pour seul héritage celui de l’histoire de la guerre. En voyant son camarade de chambrée faire sa barmitsva laïque, Jules a voulu faire la sienne. Pendant un an, il a étudié les textes principaux de la culture juive, détaillé son arbre généalogique, rassemblé les documents de son grand-père… C’est à ce moment que je lui ai donné l’étoile jaune qu’il avait gardée toute sa vie dans son portefeuille », raconte Béatrice. « Au-delà de la question culturelle, ce qui m’émeut, c’est la fraternité qui unit ces gosses. Lorsqu’ils se quittent sur le quai de la gare à Paris, ils s’étreignent pendant des heures, s’embrassent, ça respire l’amour. Ce sont des moments très forts », poursuit-elle, émue.
Goûter et révolution
Mais comment cet idéal d’une enfance juive, laïque, autonome et socialiste se transmet-il dans les faits ? Je décidais, pour répondre à cette question, d’aller passer quelques jours auprès des « ados » de 15-16 ans, les plus à même de m’expliquer ce que Corvol leur avait appris, et comment cette expérience avait influé sur la formation de leur identité. Seulement, en juillet, les ados quittent le nid douillet du château pour aller parcourir le monde. Je rejoignais donc fin juillet la joyeuse bande dans une auberge de jeunesse barcelonaise. Il y avait là 28 adolescents, et quatre animateurs âgés de 19 et 23 ans. La colo du CLEJ est d’abord une colo classique, avec ses moments de joie, de nervosité ou de flottement, ses visites culturelles, ses après-midis à la plage et ses balades sur la Rambla et ses disputes intestines. Pourtant, même loin de Clamecy, Corvol cultive ses particularités.
La première journée, après une visite du barrio gotico rythmée par les interventions des « ados » qui présentaient eux-mêmes les monuments, l’heure est à la baignade. Vers 16 heures, alors que les nuages s’amoncellent au-dessus de la plage de Barceloneta, Raphaël, le « dirlo », bat le rappel. La trentaine d’ados s’installe en cercle et en tailleur sous un abri de fortune. « Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais nous n’avons pas fait la « commémo‘ » mercredi dernier, le 16 juillet, le vrai jour anniversaire de la rafle du Vel d’hiv. Je vous propose donc de nous rattraper maintenant ! », s’époumone le grand garçon dont la casquette emprisonne les cheveux bouclés. Bougonnements et protestations s’élèvent du groupe. Pour la plupart des ados, c’est la 8e ou 9e « commémo’ »… et ils commencent visiblement à bien connaître l’histoire de la rafle. Raphaël tente une diversion : « Plutôt que de rappeler le déroulé des évènements, je vous propose, à vous qui êtes bientôt en âge de devenir des monos, d’expliquer la rafle du Vel d’hiv aux nouveaux venus ». A nous – une mono, deux ados et moi– de poser des questions aux experts es-« commémo ». Rodés à l’exercice, ils ne nous laissent pas le temps d’y réfléchir.
« Et personne n’a réagi »
Théo, 17 ans, doyen des colons, lève le doigt bien haut et se lance: « Il s’agit d’un événement majeur de la Seconde Guerre mondiale, parce qu’il y avait énormément de juifs concentrés dans un endroit clos et dans des conditions déplorables ». Yoan le coupe : « Bientôt, tous les gens de cette époque seront morts, alors il faut que cela reste dans les mémoires ». « C’est aussi parce que cela s’est passé à Paris, avec la collaboration de l’Etat français, et de la police française qui faisait du zèle », continue Emile. Tobias, long et bronzé derrière de grosses lunettes rondes, se lance dans une envolée lyrique dont il est coutumier : « C’est un événement qui illustre très bien la Shoah. Le 16 juillet 1942, la police française, sous la pression des nazis et de Pétain, enferme les juifs dans le Vel d’hiv. Les Français ont écarté un groupe entier de la société, de leur propre société ». Constantin quitte un instant son air blasé pour souligner : « Les généraux allemands ont demandé à la police française de capturer les hommes, mais la police a aussi pris les femmes et les enfants ». « Et personne n’a réagi, renchérit Léa, ça pose des questions ». Malgré les années de répétition du rituel, les lycéens prennent un réel plaisir à montrer leurs connaissances. Raphaël, le directeur éclaire : « La rafle du Vel d’hiv est le symbole de la collaboration, mais aussi celle de la résistance, car 12 000 des 24 000 personnes inscrites sur les listes de la police ont été prévenues ou cachées ».
Voyant que le récit s’essouffle, j’ose une intervention : « A quoi sert cette commémoration ? Comment utilisez-vous, aujourd’hui, les leçons de cet événement historique ? » Silence. Théo essaye : « Moi, je les ai utilisées dans un contrôle d’histoire… ». « A Corvol, on apprend comment la population juive a été rejetée… du coup on essaye de ne pas rejeter les autres. On essaye de voir à travers l’oeil de l’autre », enchaîne Tobias. Silence encore… Raphaël reprend la main : « Désormais, les juifs ne sont plus les principaux bouc émissaires, mais ce que m’a appris la rafle du Vel d’hiv, c’est que pour que ça n’arrive plus, il faut s’organiser. Dans ma vie quotidienne, je suis très sensible au racisme, à l’homophobie… A ma fac, un sans-papier n’a pas pu s’inscrire… on s’est organisés pour l’aider ». Une fois que les jeunes ont compris le type de réponse impliquée par la question, le débat se ranime… Les interventions successives évoquent en vrac le régime de Pol Pot, la guerre en Syrie, la montée du fascisme en Hongrie et en Grèce, l’antisémitisme à Paris… Jusqu’à ce que Constantin avance : « Si la haine anti-juif subsiste, c’est à cause du conflit israélo-palestinien ». « C’est un débat que nous aurons… la prochaine fois ! », coupe net Raphaël, un peu gêné.
Après s’être rassasiés de pizzas pour le dîner, place à la veillée match d’impro. Les animateurs lancent les thèmes. Pour « Ashkénazes contre Séfarades, l’empire contre attaque », le césar est attribué à l’équipe qui a mis en scène une bataille virtuelle, façon Dragon-ball Z, s’envoyant à la tête des « Tempête de méchoui ! » « Boule de foie hâché ! » « Mitraillette de Matsot ! » « Explosion de Gefilte fish ! ». La journée se termine en riant. Nous revenons à l’auberge en chaloupant et chantant au son de mini-enceintes qui crachotent la chanson Cœur de loup, véritable tube de la colo.
« On a détruit le mur de Berlin »
Au deuxième jour, nous mettons le cap vers le parc Güell, sur les hauteurs de Barcelone. Chemin faisant, les adolescents s’ingénient à me faire part de leurs souvenirs de journées à thèmes à Corvol. « Il y a quelques années, nous avons refait le procès de d’Alfred Dreyfus. On allait interroger les animateurs qui étaient déguisés en Zola, en Bernard Lazare, en militaires… et à la fin on devait dire s’il était coupable ou pas », se souvient Salomé. Jonathan ajoute : « Nous avons aussi refait le procès de Abel et Caïn. Mais ce qui m’a le plus marqué, c’est la journée à thème « Révolution française ». Les anim’ venaient nous réveiller déguisés, puis ils formaient trois équipes : le tiers-état, la noblesse, le clergé, et il fallait refaire la Révolution française ! ». « Comme pour la journée sur l’esclavage : il y avait l’équipe des blancs d’un côté, qui buvaient du jus de pomme et qui mangeaient des tartines de Nutella, alors que l’équipe des Noirs devait aller ramasser les herbes sèches de la prairie, raconte Constantin. Le schéma est le même à chaque fois : le matin, c’est l’oppression d’une équipe sur une autre, à midi, il y a un élément perturbateur, et l’après-midi, c’est révolution et goûter. Mais ce qui est vraiment intéressant, c’est de faire l’expérience pratique de l’oppression », décrypte le jeune homme. Sur ce modèle, les petits corvolois ont également détruit le mur de Berlin et renversé Big Brother. « La seule fois où on ne s’est révolté contre personne, c’était la journée des « 70 ans du cahier jaune » : chaque animateur était déguisé en personnage de chanson : le facteur polonais, le vendeur de boublishki, ou le poinçonneur des lilas », reprend Salomé. Enfin, comme le 1er tour de l’élection présidentielle tombe toujours pendant la colo, une fois tous les cinq ans, la journée est consacrée à reproduire le débat d’idées qui anime le pays. « J’étais là le 21 avril 2002, raconte Lou, désormais animatrice. Au moment de l’annonce des vrais résultats, c’est toute la colo qui était en pleurs ».
Trêve de nostalgie : il est midi, et Raphaël doit informer les ados sur leur veillée « Procès judiciaire ». « Nous sommes en Andalousie, du côté d’Almeria. Dans les serres de production intensive de fraises et de tomates, deux immigrés boliviens sans-papiers ont volé un œuf, un bœuf et une poule à un fermier. La guardia civil les a interpellés en flagrant délit. Le fermier a monté un collectif qui se portera partie civile ce soir. Il y a aussi une association de migrants qui défend les voleurs », s’égosille le directeur. Une fois les rôles distribués, les ados disposent de l’après-midi pour rédiger leurs plaidoiries. Le soir, après le repas, nous nous asseyons en cercle sur une grande place de Barcelone. Le spectacle peut commencer. Loubna, la procureur, rebaptisée Marie-Carmen Donovan pour l’occasion, expose le problème. Xavier et Lucia, les deux immigrés boliviens, sont en haillons : « Oui nous abons bolé, mais c’est parce que Xavier était à l’article de la muerte ». Clara, avocate de l’agriculteur, tient sa ligne de défense : « Vous étiez proche de la mort, mais vous avez tout de même couru pour vous enfuir ! ». Puis les témoignages se succèdent. Un agriculteur promet avoir trouvé la solution pour éviter les vols : mettre des colliers électriques à ses ouvriers et envoyer des décharges à chaque fois qu’ils demandent quelque chose. L’expert sanitaire produit la preuve de la nocivité des produits chimiques présents dans les légumes etc.A la fin de la soirée, les présidents décident de condamner les ouvriers boliviens à de la prison ferme, mais demandent un autre procès pour condamner les agriculteurs exploiteurs…
« J’étais dans le groupe, et puis voilà »
C’est la dernière fois que les corvolois nés en 1998-1999 passent ensemble leur mois de juillet. Anticipant la nostalgie qui les saisira l’année prochaine, ils échangent à la plage, pendant les trajets, aux terrasses des cafés sur ce que leur a apporté Corvol, cette « période de leur vie qu’ils n’oublieront jamais ». « En 2008, j’ai fait ma première colonie de vacances. Je me suis retrouvé dans le groupe de Théo, Emile et Yoan. Dès le deuxième soir, on est descendu dans la nuit, et on a couru dans le parc. J’étais dans le groupe, et puis voilà », se souvient Jonathan, qui retient avant tout « les délires entre copains ». Pour Constantin, qui a vécu une scolarité difficile après le décès de son père, Corvol était un « repère », un « soin » : « Cela me faisait du bien de voir des gens proches, que je connaissais depuis longtemps, alors que je changeais tous les ans d’école ». Lou anime aussi cette année sa dernière colo : « Nous, on était un groupe de 10, 12 potes très soudés. Il n’y a pas eu de couple jusque tard, parce qu’on se considérait comme des frères et sœurs. Je les voyais aussi le reste de l’année, on habitait le même quartier… Corvol m’a aussi beaucoup fermée aux autres. Pas besoin de s’adapter, de se faire de nouveaux amis, puisque j’avais déjà les miens et qu’on pensait pareil ! Désormais, ce sera moi toute seule dans la vie. Je flippe vachement ».
« A 19 ans, j’ai été propulsé directeur : je gérais 80 enfants et 15 animateurs. Corvol m’a fait grandir », explique Raphaël, faisant le bilan sur ses quinze dernières années de colo. Les ados rendent aussi grâce à cette « pédagogie active » qui les a placés en situation d’êtres responsables. « Nous avons préparé notre voyage nous-mêmes. Nous avons fait deux ou trois réunions, pendant lesquelles nous avons décidé des villes où nous allions aller. Puis on s’est réparti par groupe au café, et on s’est renseigné sur les monuments de la ville attribuée à notre équipe. On discute aussi des activités, même si en définitive ce sont les animateurs qui décident », raconte fièrement Jonathan. Tom explique : « On veut nous faire apprendre des choses en s’amusant. On élit les trésoriers de la colo, et les délégués de groupe qui, chaque vendredi, ont leur mot à dire sur les activités du samedi, peuvent demander des musiques pour la boum ou plus d’eau chaude dans les douches. Les grands organisent eux-mêmes leur journée à thème ! ». « La spécificité de Corvol, décrit Lou, animatrice, c’est que, comme nous avons nous aussi été dans la même colo il n’y a pas si longtemps, nous ne prenons pas les ados pour des idiots. Ils peuvent poser toutes les questions qu’ils veulent sur le fonctionnement de la colo, et j’essaye de tout leur expliquer, de ne jamais avoir une position d’autorité ».
Une identité en creux
Les adolescents ont plus de mal à décrire les mécanismes par lesquels s’est effectuée la transmission d’une culture juive. D’abord parce que pour beaucoup, cette culture précédait les colonies de vacances. La mère de Jonathan lui lisait des légendes juives lorsqu’il était enfant. Jonas était biberonné au films et aux livres sur la Shoah. Igor, Eve et Rachel ont entendu les histoires de leurs grands-parents dont les familles ont été tuées dans le ghetto de Varsovie, au moment du génocide par balle ou dans les camps de la mort. Ensuite, parce que s’ils aiment apprendre les grands évènements historiques qui scandent la vie du peuple juif et le folklore qui s’y rattache (danses, chants et fêtes), les adolescents ont encore du mal à se l’approprier, soit parce qu’ils sont trop jeunes, soit parce que le dernier événement qui la constitue remonte bientôt à 70 ans…
Leur identité juive se dessine en creux. En réaction à l’antisémitisme d’abord « Cette année, dans ma classe, il y avait une fille avec qui je m’entendais bien. Quand elle a découvert que j’étais juif, j’ai vu dans ses yeux qu’elle cherchait les indices grâce auxquels elle aurait pu deviner ma judaïté. Puis elle m’a dit : « Tu sais que c’est mal vu ici ! Noooon j’rigole » », raconte Emile, en classe à Hélène Boucher, un lycée parisien. « Ensuite, il y’avait un autre type qui me disait tout le temps : « Ca va mon p’tit juif ? », et moi, je sentais que ça l’obsédait, que c’était malsain. Toute l’année, l’antisémitisme était au cœur de l’actualité, et les gens se permettaient des remarques qui étaient tabou l’année dernière », poursuit le lycéen. Constantin, qui vient d’un milieu plus populaire, raconte : « Moi, mes copains sont des « renois » et des « rebeus». Certains sont antisionistes, ce que je peux comprendre. Mais le problème, c’est lorsque ça devient de l’antisémitisme. Certains passent par Israël pour détester les juifs ». Quant à Igor, 19 ans, il a découvert Dieudonné il y a deux ans. « Au début, ça m’a fait beaucoup rire. Je me suis même engueulé avec mes parents parce que je voulais aller au spectacle. Puis il y a eu de plus en plus de propos qui allaient trop loin. La chanson Shoananas, par exemple, me blesse. Quand il raconte qu’il rencontre quelqu’un qui lui dit que sa grand-mère est morte pendant la Shoah, et qu’il répond, « je m’en fous, je la connais pas », ça me dérange », raconte l’animateur.
Leur identité juive se construit aussi en se distinguant d’un autre type de juifs, qu’ils appellent les « chalalas », et du repli communautaire qu’ils décèlent dans cette mode. « Dans mon ancien lycée il y avait un groupe de juifs très frimeurs : ils portaient les vêtements les plus chers, sortaient toujours ensemble, aux mêmes boîtes du XVIe arrondissement. Certains veulent même se convertir pour faire partie de leur bande ! Moi, qu’ils s’habillent cher et ne sortent qu’entre eux, ça n’est pas mon problème. Mon problème, c’est qu’on associe ce mode de vie bling bling au judaïsme », regrette Igor. Les adolescents font rimer « chalala » et manque d’ouverture : « Lorsqu’ils ont vu que je mangeais du porc et que je ne croyais pas en dieu, des mecs de ma classe m’ont dit que je n’étais pas une vraie juive, et j’ai dû batailler pendant une heure pour leur expliquer qu’ils n’étaient pas les seuls », déplore Rachel. Elle ne dispose pas encore de l’arme fatale qu’Annette a mis au point en soixante ans de judaïsme laïque : « Quand mon voisin orthodoxe me cherche des noises sur la religion, je lui réponds que les nazis n’ont pas fait la différence, en 1943, entre ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient pas ! »
Le social au coeur
« Et pour toi, qu’est-ce que ça signifie, l’attachement aux valeurs socialistes de Corvol ? » A ma question, la réponse est unanime : « La caisse de bonbons ! ». Au début des colos, les enfants sont invités à verser l’intégralité de leurs bonbons dans une caisse commune. Ils seront ensuite répartis à égalité. Elle est aux yeux des enfants le symbole même de la philosophie corvoloise: « Quand Loubna s’est fait volé son porte-monnaie, au début du séjour, nous nous sommes tous cotisés pour qu’elle ait de l’argent de poche. Corvol t’apprend à penser pour les autres, et pas seulement pour ta pomme… et à accepter la frustration », explique Emile. « L’égalité est présente partout, même dans les choses les plus insignifiantes. On a toujours dans la tête le social, le partage, l’égalité. C’est aussi une colo où il n’y a aucune discrimination », affirme Constantin. Rachel abonde : « Nous sommes plus sensibles que les autres à la question de l’exclusion. Si j’étais très engagée dans les manifestations contre l’expulsion de Katchik et Léonarda, c’est un peu grâce à Corvol ». « Par-dessus tout, l’esprit corvolois, c’est ne pas penser qu’à soi, être ouvert, respectueux de l’autre. On peut mettre en question des règles de vie. Ici, personne ne m’empêche d’exprimer mon opinion, on discute tout le temps, on se pose des tas de question. Tu ne te sens pas emprisonné dans quelque-chose », souligne Eve.
Sionisme et socialisme, des tourments corvolois
Alors que depuis le 8 juillet, la guerre fait rage dans la bande de Gaza, que les manifestations emplissent les rues de Paris et que l’opération « Bordure protectrice » occupe les « Unes » et les réseaux sociaux, le sujet est absent des discussions des ados. « A Corvol, c’est tabou. On est d’accord pour pas être d’accord, et on évite d’en parler, parce que cela risquerait de faire exploser l’association », explique Raphaël. S’il affirme être très opposé à la politique du gouvernement Netanyahou, le dirlo ne veut pas s’avancer plus, par « manque de connaissance du sujet ». Même réponse chez Lou et chez Igor. Les ados sont moins inhibés : « Ils sont cons des deux côtés », essaye Jonathan. « Israël était une nécessité après la guerre, mais aujourd’hui ça attise plus la haine qu’autre chose », tente Constantin. « Je parle d’Israël comme du conflit en Syrie, je n’ai aucune attache là-bas, estime Rachel. On sait que ça fait débat dans l’association parce que les monos nous l’ont dit ».
Pour trouver l’explication de ce silence gêné, il faut se tourner vers les « vieux » adultes du CLEJ, qui racontent l’histoire politique récente de la communauté juive. « Le Bund a évolué. Antisioniste au départ, le CLEJ, descendant de son mouvement de jeunesse, a revu sa position au lendemain de la guerre des Six jours en 1967, en ajoutant un quatrième pilier à sa Charte, celui de ‘l’attachement à l’existence de l’Etat d’Israël’. C’est le fruit d’un compromis au sein des membres du CLEJ, chez qui on trouve aujourd’hui encore des avis radicalement opposés. Nous avons du mal à discuter sereinement tant cette question a une dimension affective », explique Joëlle Laugier, présidente du CLEJ. La question israélienne provoque régulièrement des débats au « Comité » qui dirige l’association. Une partie des parents du CLEJ défend l’idée d’un voyage en Israël pour les jeunes adultes. Bernard est de ceux-là : « Qu’est-ce que c’est qu’un projet juif en France sans un lien avec la religion et sans une connexion avec Israël ? En France, le judaïsme laïc fonctionne avec un logiciel passéiste. Chanter des chansons qui datent d’il y a 30 ans – Che Guevara sur un air de salsa – n’est pas une piste. Nous devons nous tourner vers un judaïsme vivant, or cette énergie créatrice existe en Israël et aux Etats-Unis ». A l’autre extrémité, Gabriel explique : « La communauté juive organisée glisse de plus en plus à droite. Il est très important pour moi que des juifs clament haut et fort leur opposition à l’Etat d’Israël en tant qu’Etat religieux et colonisateur». Joëlle Laugier se fait le relai de la position qui permet à Bernard et Gabriel de se retrouver dans la même association : « Le CLEJ revendique un attachement à l’existence de l’Etat d’Israël, tout en s’autorisant à critiquer la politique qui y est menée. Nous soutenons tous les processus de paix durable dans la région, qui permettraient aux palestiniens et aux israéliens de s’épanouir ».
« Un problème de recrutement »
Mais, pour elle, le danger qui menace Corvol est ailleurs. « Les animateurs sont de moins en moins motivés par la transmission de notre identité », déplore-t-elle. Raphaël, le directeur de la colo, est plus brut de décoffrage : « Plus les années passent, plus le public est constitué d’ enfants de la bourgeoisie qui habitent le Marais ou le Ve arrondissement. Transmettre des valeurs socialistes à des gosses qui n’ont même pas idée de ce qu’est la pauvreté, c’est un peu étrange », explique le titi du XXe arrondissement de Paris. Gabriel, ancien directeur de Corvol, explique : « Ceux dont les grands-parents étaient ouvriers au Bund ont grimpé dans l’échelle sociale, et représentent aujourd’hui pour la majeure partie l’intelligentsia parisienne : des avocats, des médecins, des producteurs de cinéma etc. Comme nous ne recevons aucune subvention, le prix des colos est très élevé, autour de 1000 euros, ce qui accentue cette tendance. Enfin, les juifs issus de classes populaires, à priori plus concernés par notre projet, sont souvent, aujourd’hui, religieux et/ou de droite. La solution à ce problème se trouve peut-être dans des partenariats entre nos colos et celles des mairies de banlieue ».
Demain, les ados reprendront la route pour passer les trois derniers jours de leur colo à Corvol. Arrivés au portail, ils courront vers le château, embrasseront leurs cadets, mangeront des bananes au chocolat autour du feu de camp en chantant une dernière fois les chansons du cahier jaune, avant de rejoindre leurs parents pour poursuivre leurs vacances. Mais ce soir, Raphaël porte un toast à l’avenir de la colo dans un silence ému. Puis tous lèvent bien haut leur verre de sangria, la gorge nouée, et, comme l’ont fait avant eux des centaines de petits corvolois, hurlent à l’unisson : « Leheim ! »
Elsa Sabado
Elsa Sabado a quitté le collectif pour voguer vers d’autres aventures. Retrouvez son travail chez Hors Cadre.