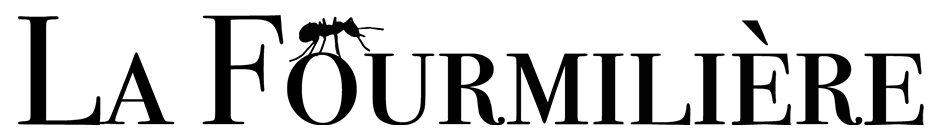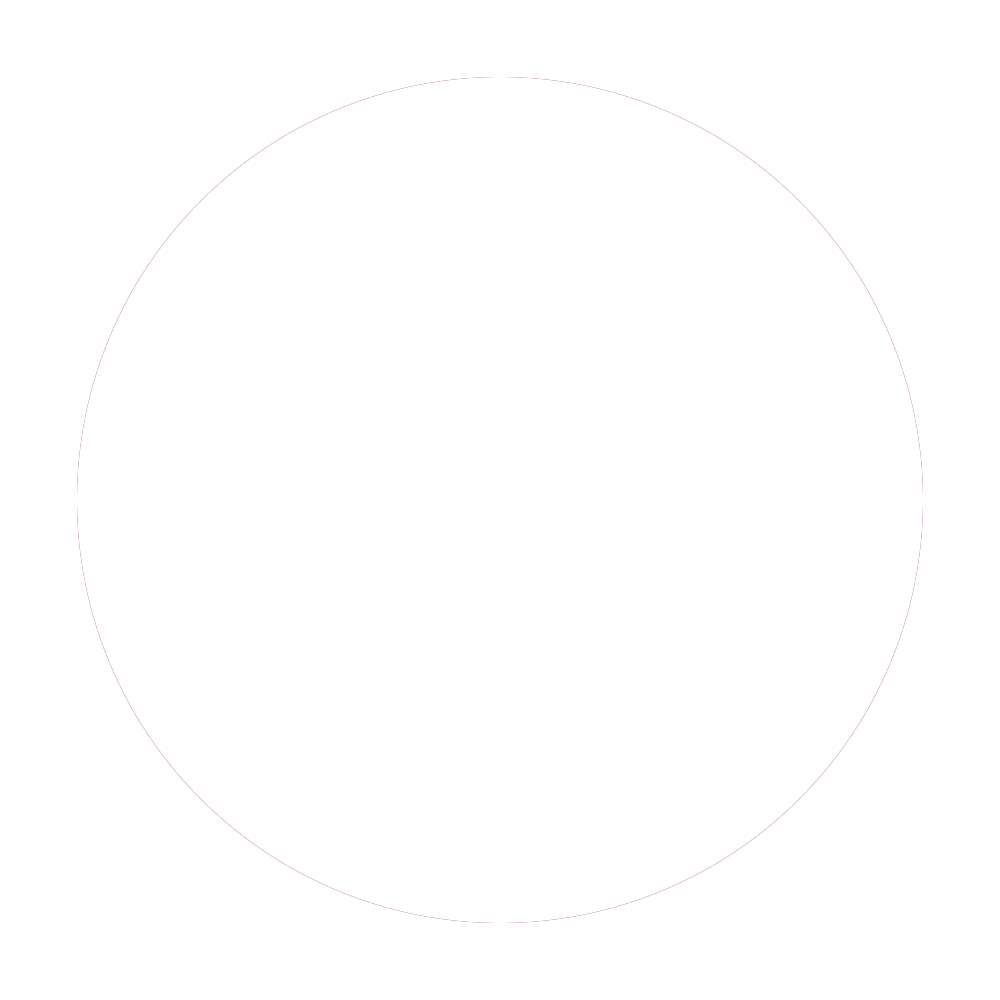Alors que vient de sortir Dear White People, un film satirique autour du racisme sur les campus américains, une nouvelle mouvance tout droit venue de Twitter est en train d’émerger en France : l’ « afroféminisme » se veut une réponse radicale à la conjugaison du sexisme et du racisme. Rencontre avec ces militantes détonantes.
« Fatou est un prénom, pas une insulte », « Ta main dans mon afro, ma main dans ta gueule »… Coupes afro au vent, tout tissus wax dehors, un cortège aux slogans inhabituels détonnait dans la manifestation pour la Journée de la femme, le 8 mars dernier. Pour la première fois depuis longtemps, des femmes noires défilaient parce qu’elles étaient des femmes noires. Ces jeunes militantes au discours radical, politisées et réunies via leurs échanges sur Twitter, revendiquent l’étiquette d’« afroféministes ». Grazia est parti à leur rencontre, pour tenter de comprendre pourquoi elles veulent suivre une autre route que les féministes « classiques ». Economiss, Kiyémis, Mrs Roots, Colonel Nass… Toutes veulent se faire appeler par leur « nom de guerre ». Car toutes ont entendu, de la bouche de leur mère : « Tu vas devoir te battre deux fois plus que les autres. » Elles racontent, chacune à leur façon, des expériences fondatrices face à la discrimination. « Lorsque j’étais étudiante en école de commerce, le chef de service d’une grande banque a refusé de me prendre en stage. Une autre stagiaire m’a raconté que lorsqu’il a vu la photo sur mon CV, il a dit : « Je ne prends pas de Noirs dans mon service, j’ai déjà eu des problèmes avec eux ». J’en ai pleuré. » A l’époque, l’école de la jeune fille ambitieuse lui a conseillé de faire profil bas. Aujourd’hui encore, elle préfère, malgré sa colère, rester anonyme, de peur que cela ne lui porte préjudice dans le monde du travail. Mrs Roots, 25 ans, étudiante en édition, est plus posée, mais sa révolte n’est pas moins bouillonnante. Elle a compris pourquoi elle étouffait en France lors d’un voyage en Finlande : « Là-bas, personne ne me demandait quelles étaient « vraiment » mes origines, je n’avais plus à choisir entre l’identité française, antillaise et congolaise. » Colonel Nass, 24 ans, « fille de CSP– » devenue ingénieure dans l’industrie pharmaceutique, ne mâche pas ses mots elle non plus : « Lors d’un stage humanitaire aux Comores, mon pays d’origine, j’ai vu les gens qui travaillaient comme des chiens dans les exploitations de vanille et d’ylang-ylang d’un grand parfumeur, alors que cette terre aurait dû leur appartenir. »
Nafissatou Diallo
Colonel Nass a réellement attrapé le virus lors de l’affaire Nafissatou Diallo, en 2011 : « On entendait dire qu’elle était trop noire, trop moche, trop pauvre pour s’être fait violer. » Mais c’est l’exposition controversée Exhibit B, en novembre dernier à Paris, qui pour elle comme pour ses « consœurs », a fait déborder le vase. Et les a persuadées de porter leur combat dans la rue. L’expo en question reproduisait les « zoos humains » de la fin du 19e siècle « Une fois encore, les Noirs étaient présentés dans une position de soumission. Aux manifestations, devant le lieu où elle se déroulait, l’image était caricaturale : les manifestants noirs prenaient des lacrymo pendant que les spectateurs blancs, au balcon, buvaient du champagne et prenaient des photos avec leur smartphones… On nous a dit qu’on ne comprenait rien à l’art », raconte Mrs Roots, qui a écrit un texte à ce sujet sur son blog dédié à la littérature « afropéenne ». Les filles ont participé à ces protestations en ordre dispersé. La première fois qu’elles se sont vraiment réunies, c’était en février, lors d’une conférence organisée par la réalisatrice afroféministe Amandine Gay autour de son documentaire qui donne la parole à des femmes noires françaises. Son titre : Ouvrir la voix.
Nicky Minaj
Car lorsqu’il s’agit d’évoquer racisme et sexisme, aucun mouvement ne trouve grâce à leurs yeux. « Les organisations panafricaines ou les Indigènes de la république évacuent totalement l’axe du féminisme. De leur côté, les organisations féministes traditionnelles sont « blanches » », explique Colonel Nass. Les Afroféministes reprochent par exemple à Osez le féminisme (OLF) son profil sociologique “Blanche de classe moyenne”, mais aussi le type de féminisme qu’elles défendent. « Voile, talons, mini-jupe… Je suis opposée à tout objet qui différencie les hommes et les femmes dans l’espace public », explique ainsi Caroline de Haas, fondatrice d’OLF. Ce à quoi l’essayiste Rokhaya Diallo, tenante d’un féminisme plus radical, comme les afroféministes, répond : « Les féministes blanches veulent se départir des attributs de beauté parce qu’ils les infériorisent vis-à-vis des hommes. Mais pour les noires, à qui on a toujours dit que leurs traits étaient laids, le fait de se battre pour qu’ils soient reconnus comme beaux prend un tout autre sens. » Est-ce pour cela qu’Anaconda, le dernier clip de Nicky Minaj, dans lequel elle joue allègrement de son postérieur, a fait l’unanimité chez les afroféministes ? Alors qu’il ferait faire des vrilles dans sa tombe à Simone de Beauvoir, Mrs Roots et ses amies juge que la chanteuse réussit ainsi l’exploit de « se réapproprier les codes racistes attribués à la sexualité noire »…
Un remake du « black féminism » ?
Pour les femmes noires, se retrouver en étau entre les intérêts des hommes noirs et des femmes blanches n’est pas une nouveauté. « Dans les années 60-70, au moment du nationalisme noir et du black power, on a demandé aux femmes noires de faire passer la question du genre derrière la question de la race. C’est par leur place dans la société qu’elles savent que toute hiérarchisation entre les causes leur est préjudiciable », explique la chercheuse Maboula Soumahoro, spécialiste de la question noire aux Etats-Unis. Si ces nouvelles afroféministes françaises ne se revendiquent pas ouvertement de l’héritage d’Angela Davis et de son ouvrage phare Femmes, races et classe, elles semblent y avoir puisé l’essence et la radicalité de leur discours : pour elles, impossible de désolidariser les questions de races, de classes et de genres. Assiste-t-on pour autant aujourd’hui en France à un remake du « black feminism » américain des seventies ? « La différence, c’est que là-bas, les noirs étaient dès le départ une composante du tissu national, alors qu’en France on estimait que c’était une question qui se posait dans les colonies, décrypte Maboula Soumahoro. Mais aujourd’hui, il va falloir envisager les choses autrement, car certains en ont assez d’être exclus des causes universelles, les afroféministes comme les féministes musulmanes. » Que va devenir l’embryon du mouvement afroféministe en France ? Va-t-il se contenter d’un réseau sur Twitter ou se structurer en organisation ? Il balbutie encore. Pourtant, les afroféministes estiment avoir relevé un premier pari : « On veut exister, être visibles, avoir enfin la parole, conclut l’une d’elle, Kiyémiss, du haut de ses 22 ans. C’est en parlant et en se montrant qu’on fera évoluer les mentalités. »
ENCADRÉ
« Je m’assume telle que je suis »
Sur Twitter, les quatre amies échangent aussi sur les problèmes spécifiques des femmes noires. La question du cheveu est incontournable : « Les médias et/ou les mecs nous demandent d’être nappy (natural+happy)… à savoir porter l’afro et ainsi assumer nos racines. Mais lorsqu’on s’y plie, on entend nos coupes comparées à des « dessous de bras », comme vient de le faire le magazine Public à propos de l’afro de Solange Knowles, la sœur de Beyoncé », détaille Economiss. Un constat partagé par l’essayiste Rokhaya Diallo, qui prépare un livre sur les cheveux afros : « Lorsque vous grandissez avec l’idée que ce que vous ne pouvez pas montrer publiquement ce que vous êtes, cela n’est pas anodin. La question du cheveu est très politique. Lorsque Christiane Taubira porte des tresses, cela signifie : « Je m’assume telle que je suis ». Le cheveu noir suscite une telle fascination qu’un des problèmes des femmes noires, c’est qu’on leur touche les cheveux dans la rue. » Dans la rue, justement, ces jeunes femmes l’assurent, elles subissent un harcèlement bien spécifique : « On m’appelle « ma panthère, ma tigresse » », affirme Economiss. « Il faut avoir des grosses fesses, la peau d’une certaine couleur, ne pas trop bien s’exprimer, être bonne à marier et pas « toubabisée » (blanchisée), s’insurge Colonel Nass. Notre vie entière est sujette à codification. »
Elsa Sabado
Elsa Sabado a quitté le collectif pour voguer vers d’autres aventures. Retrouvez son travail chez Hors Cadre.