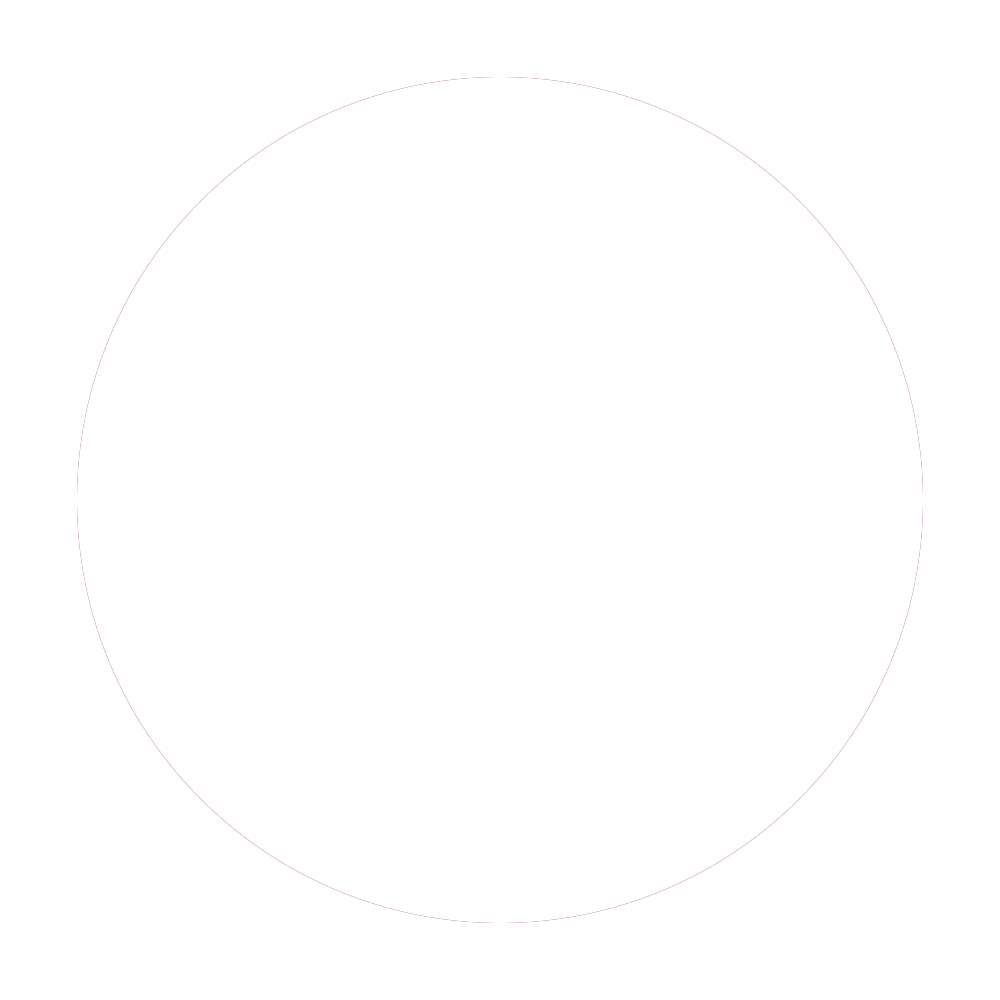Elle fut l’une des « irréductibles » de la lutte contre la fermeture de l’abattoir Gad, à Lampaul-Guimiliau, dans le Finistère. après 21 ans de « boîte », pascale, au chômage, vit aujourd’hui avec 34 euros par jour. Du travail, elle s’en persuade, elle va bien finir par en trouver. reste la colère.
Ses yeux d’un bleu azurin disent une blessure que son franc sourire réussit presque à masquer. Le 11 octobre 2013, la vie de Pascale a « explosé » avec la fermeture de l’abattoir Gad de Lampaul-Guimiliau, dans le Finistère. Depuis 21 ans, c’était « sa boîte ». Elle travaillait au siège de Saint-Martin-des-Champs, à quelques kilomètres de l’usine.
Depuis février 2013 et le placement de la société en redressement judiciaire, elle se battait pour la sauver. Mais en septembre 2013, le rideau est baissé. Cette Lampaulaise pure sucre de 42 ans a grandi à l’ombre de l’énorme abattoir qui se dresse en contrebas de ce bourg de 2 000 âmes. Le garage autrefois tenu par ses parents marque encore l’entrée du village.
Elle est pourtant arrivée chez Gad, un peu par hasard, un bac pro de vente en poche et l’envie d’arrêter là ses études. En 1992, après un remplacement d’été, elle décroche un poste de télévendeuse. « Je commercialisais la viande auprès des grandes surfaces. À l’époque, la vente par téléphone, je disais que c’était nul », s’amuse celle qui a finalement fait toute sa carrière au bout du fil.
Ce boulot lui plaisait. Mère de trois enfants, membre du conseil municipal de Lampaul-Guimiliau depuis ses 28 ans, Pascale n’est pas du genre à se plaindre. Une équipe qui fait front, un salaire pour vivre et le sentiment de bien faire son travail suffisent à son équilibre. En évoquant ces années, sa gorge se serre : « Je n’ai même pas pu dire au revoir à mes clients. »
« SAUVONS LAMPAUL »
Alors, c’est tout naturellement qu’elle prend part à la lutte des salariés pendant les 7 mois de redressement judiciaire. De cette femme fluette émane une énergie impressionnante. Avec d’autres, elle crée l’association Sauvons Lampaul pour financer les actions menées contre la fermeture de l’abattoir. C’est ici que sont élevés les cochons et ici que sont élaborés saucisses et saindoux, les produits transformés qui assurent les maigres marges de l’activité d’abattage-découpe. « C’est ce qu’on voulait faire comprendre, mais on n’a pas réussi », déplore-t-elle.
Alors que la fermeture se profile, la quadragénaire s’accroche au piquet de grève sur le parking de l’usine. À l’intérieur, des cochons, encore à abattre, sont la seule monnaie d’échange des salariés pour obtenir de meilleures conditions de licenciement. Cette petite femme aux cheveux de feu sera de celles et de ceux qui portent les autres tandis que se dessine la fin de leur monde. « Le parking, il n’y avait que là qu’on était bien », explique-t-elle. Le quitter, c’était lâcher leur usine.
Sur son téléphone, Pascale fait défiler les photos, comme autant de faits d’armes : le blocus du siège, la confection de cochons en pâte d’amande, celle de tee-shirts roses imprimés du mot « irréductibles »… Les voir à nouveau fait remonter des souvenirs qui la font rire et l’émeuvent à la fois. La colère renaît aussi, à l’évocation du 22 octobre 2013, date à laquelle les salariés de Lampaul-Guimiliau, sacrifiés pour sauver le deuxième abattoir du groupe, à Josselin, dans le Morbihan, viennent bloquer ce site et se font expulser manu militari par leurs collègues.
CONTRECOUP
Lorsqu’elle retrouve un poste 2 mois après la fermeture, Pascale culpabilise : « Pourquoi moi et pas les autres ? » C’est un remplacement de congés maternité, payé au SMIC. Un CDD de 7 mois. Un de trop pour pouvoir profiter du contrat de sécurisation professionnel qui garantie 1 an de maintien de salaire et un accompagnement renforcé aux licenciés. Elle accepte pourtant le risque et reprend le boulot.
Au début de l’année, Pascale accuse le contrecoup. Elle divorce, déprime mais continue à travailler. À l’été, la fin de son CDD arrive. Elle ne sera pas gardée. Aujourd’hui au chômage, elle doit vivre avec 34 euros d’indemnisation par jour. « Qu’ils essaient ceux qui disent que les chômeurs sont des fainéants », commente- t-elle ! Bien sûr, elle cherche, et répète en souriant, comme pour s’en convaincre, qu’elle arrivera bien à trouver. Mais en passant devant les bâtiments blanc et rouge de l’ancien abattoir, elle l’avoue : « Ça fait toujours mal aux tripes. » Si la femme a commencé à tourner la page, c’est la douleur qui semble « irréductible ».
Marion Perrier