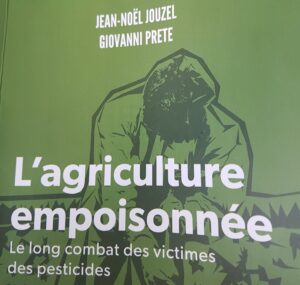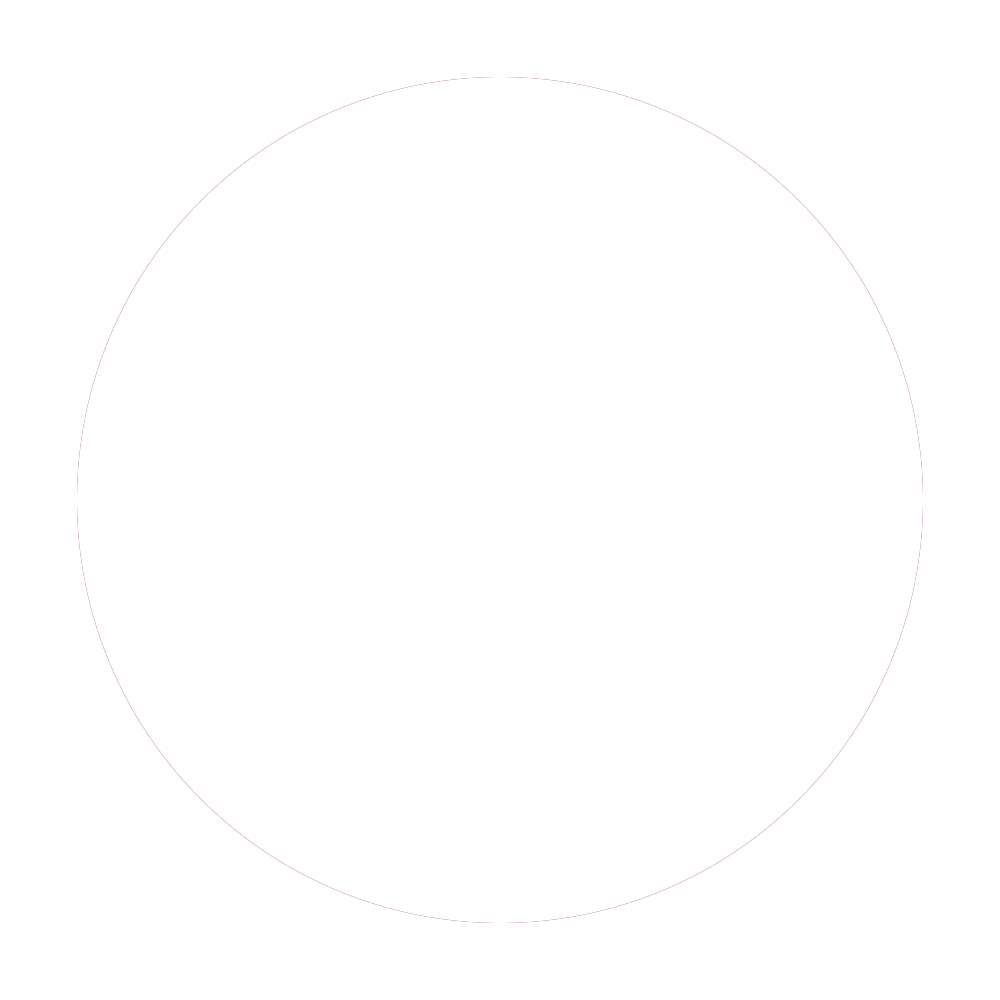L’Humanité – Alors que le dernier patron d’Amisol, fermé en 1974, pourrait bénéficier ce vendredi d’un non-lieu dans une des affaires les plus emblématiques du scandale de l’amiante, ses anciennes salariées veulent que sa responsabilité soit reconnue.
Publié dans L’Humanité, le 8 février 2013
Que la justice pénale reconnaisse la responsabilité de leur employeur mis en examen pour empoisonnement et homicide involontaire. C’est tout ce que demandent celles qui sont la mémoire vivante d’un des premiers scandales de l’amiante. Vendredi, la chambre l’instruction de la cour d’appel doit prendre sa décision concernant le non-lieu requis par le parquet à l’égard de Claude Chopin, dernier patron de l’usine clermontoise Amisol. Réunies la semaine dernière à la Maison du peuple de Clermont-Ferrand, Josette, Marie-Jeanne, Maria-Raquel et beaucoup d’autres anciennes ouvrières ont tenu à raconter leur histoire. Une nouvelle fois, elles se le sont promis, elles ne lâcheront pas. « L’histoire a tranché, les patrons de l’amiante sont des empoisonneurs. Maintenant, il faut que la justice passe ! »assène Josette Roudaire, une ancienne ouvrière et syndicaliste CGT. Avec ses collègues, cela fait trente-neuf ans qu’elle lutte.
Des conditions de travail effroyables
Jusqu’à la fermeture d’Amisol, en 1974, elles ont travaillé l’amiante dans des conditions effroyables. Livré à l’usine dans des sacs, le matériau était broyé, tressé et transformé pour répondre aux besoins d’autres entreprises. « J’étais à la filature, raconte Maria-Adélia Valente. Parfois, il y avait tellement de poussière qu’on ne voyait pas la collègue à un mètre de distance, de l’autre côté de la machine. » « Dans le bus, les Michelin me disaient : “Tu as été plumer tes oies ?”, tellement j’étais blanche », se souvient l’ouvrière.
« L’enfer blanc » décrit par les journaux, peu après la fermeture de l’usine, saute aux yeux sur les photos d’alors. Sur les murs, les fibres d’amiante forment de gigantesques toiles d’araignée. Au sol, le matériau s’entasse et les machines, vétustes, sont recouvertes de poussière. Pourtant, lorsque la manufacture ferme, en 1974, c’est d’abord pour sa réouverture que luttent les 271 salariés, qui l’occupent pendant de longs mois. « On était des mères de famille. On ne demandait qu’à travailler », explique Marie- Jeanne Outurquin. Si la maladie et la mort ont commencé à frapper, il faudra la visite d’un
scientifique de Jussieu, Henri Pézerat, en 1976, pour que les anciens d’Amisol apprennent
les dangers de l’amiante.
Alors qu’en France, une première alerte avait été lancée en 1906 par l’inspection du travail de Caen et que l’asbestose, une fibrose pulmonaire liée à l’inhalation d’amiante, était reconnue dans le tableau des maladies professionnelles depuis 1950, personne n’avait jusqu’alors alerté les travailleurs clermontois. Ni leurs employeurs, Maurice Chopin puis Claude, son fils, ni le médecin du travail pourtant spécialiste de l’amiante. La lutte change alors d’objectifs. La colère donne des forces aux ouvrières qui, petit à petit, obtiennent leurs premières victoires, un suivi médical, une indemnisation. « Elles ont été les premières à prendre conscience de la nécessité impérative de briser le silence et de se battre pour leurs droits », souligne Annie Thébaud-Mony, sociologue à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. En 1995, elles créent le premier Comité amiante prévenir et réparer. En 1997, la substance est définitivement interdite.
Plainte au pénal
La même année, elles déposent une plainte au pénal contre Claude Chopin, qui a dirigé l’usine pendant ses six derniers mois. Son père, lui, est décédé. L’instruction touche aujourd’hui à sa fin, mais, en novembre, l’avocat de l’ancien PDG a demandé un non-lieu, estimant que la durée de l’enquête portait atteinte à son droit à un procès équitable. Le parquet, quant à lui, estime que, « compte tenu des difficultés de trésorerie de l’entreprise, de la situation sociale en son sein, on ne voit pas quel type de mesure aurait pu être mis en place ». « Un scandale dans le scandale ! » pour Jean-Paul Teissonnière, avocat des victimes. « Si l’employeur n’avait pas les moyens de prendre des mesures de sécurité, il suffisait d’arrêter les machines », résume- t-il. Pour les ouvrières, il est hors de question de baisser les bras.
Vendredi dernier, elles se sont unanimement prononcées en faveur d’un pourvoi en cassation, dans le cas où la décision de la cour d’appel leur serait défavorable. « Claude Chopin a empoché des millions. Pour nous, l’héritage d’Amisol, c’est le poison et la maladie, rappelle Josette Roudaire. Nous ne redonnerons pas vie aux morts d’Amisol, mais cette action devant les tribunaux, c’est pour que cela ne se reproduise plus jamais. » Car leur combat, elles le mènent d’abord pour l’avenir, pour que les crimes industriels ne soient pas marqués d’impunité.
Leur souffrance et leurs maux, elles en parlent peu, et toujours avec dignité. Amisol, pour elles, c’est aussi ça, des stigmates qu’elles portent dans leur corps, dans leurs poumons sous forme de plaques pleurales, les douleurs, la gêne respiratoire et, en permanence, la menace du cancer. « La blessure, on la garde. Malgré tout, elle est là. On ne la digère jamais. Il faut la porter tous les jours », souffle Maria-Raquel Fernades, dont le père, qui avait aussi travaillé à Amisol, a été emporté par un cancer. Autour d’elle, on sent les ouvrières soudées. C’est sans doute ce collectif qui a fait la force de la lutte des anciennes d’Amisol.